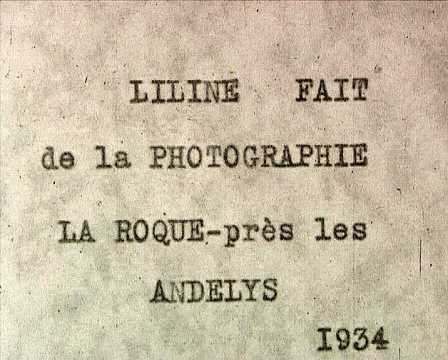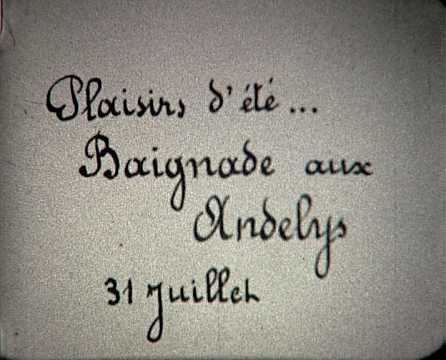La Seine nautique : canotage et canoés (1830 - 1960)
- Publicité pour les Chemins de Fer de l’Ouest - 1887
Idéalement situés entre Paris et l’Angleterre, la Seine, son estuaire, et plus largement le littoral normand, ont très tôt attiré les Parisiens amateurs de loisirs nautiques.
La mode des bains de mer, auxquels on prête des vertus thérapeutiques, commence en 1820 à Dieppe, la plage la plus proche de Paris. C’est le début des stations balnéaires qui vont fleurir sur l’ensemble de la côte. On vient y assister notamment aux régates. Ces courses entre bateaux attirent une clientèle fortunée, disposant à la fois des moyens financiers et du temps nécessaire pour se permettre ces loisirs.
Photogramme tiré du film : Centenaire de l'association, Robert Absire, 1975
"Baigneurs au Tréport", Louis Chesneau 1912
"Avant les régates à Dieppe" Jean Alfred Taiée "eau-forte" 1876 MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Don d'Alphonse Revilliod
Toute une économie s'organise autour de ces événements sportifs et mondains : on organise des tournois de lawn-tennis et des concours hippiques. Bientôt, partout sur le littoral, on construit des hôtels particuliers, des casinos… Deauville sort de terre et devient la “Reine des sports et de l’élégance”.
"Concert au casino de Deauville", 1865, Eugène Boudin. Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon. © Washington, National Gallery of Art
Cependant les classes moyennes parisiennes rêvent elles aussi de conquérir la Seine et de la descendre jusqu’à la mer.
Le « canotage » naît à Paris et dans ses environs vers 1830. C’est une navigation sur des embarcations légères à l’aviron et à la voile qu’on peut pratiquer pour la promenade. On pense à la sortie en Yole d’Henriette où elle découvre « une espèce de tendresse pour l’herbe, pour l’eau, pour les arbres ». “Partie de campagne” Jean Renoir 1936
Claude Monet, Régates à Argenteuil, 1872
Très vite, des courses entre canotiers sont organisées.
Au cœur du XIXème siècle, l’industrialisation des berges de la Seine et l’augmentation de la batellerie dégradent les eaux de la banlieue parisienne. Les canotiers cherchent alors à naviguer plus loin, d’abord dans la vallée de l’Oise puis en Normandie. Chaque printemps, les voiliers parisiens descendent la Seine en flottille pour se rendre à la saison des régates normandes. Rouen n’est située qu’à 125 km de l’embouchure du fleuve. Cependant, avant de gagner la mer, les fleuves et les rivières constituent le cadre privilégié de l’expérimentation des « plaisirs de l’eau » tels que la baignade, la natation, la pêche à la ligne, le canotage et les sports nautiques.
Photogramme tiré du film : Les Andelys, Fernand Bignon, 1933
L’esprit très romantique de l’époque correspond à la contemplation des ruines ou de la nature depuis l’eau. Et la Normandie est un des lieux où apparaît cette nouvelle peinture dite impressionniste qui se libère de l’académisme. Une incitation de plus à découvrir ces paysages in situ.
Photographie de André Schnellbach - Abbaye de Jumièges
Sur le Seine apparaissent des barques de promenade qui peuvent amener des touristes sur l’eau de Rouen à Jumièges par exemple. Ces barques sont parfois munies de cabines pour protéger les passagers des intempéries. On passe Vernon, Les Andelys et Château-Gaillard, Rouen, la ville aux cent clochers, et l’abbaye de Jumièges.
Photogramme tiré du film : "Roche-Guyon," Fernand Bignon, 1933 Photographie : " Château Gaillard" André Schnellbach - 1910
Guy de Maupassant : “D’autres vont en Amérique voir les chutes du Niagara (...) ; d’autres vont aux Indes contempler les bayadères ; (...) d’autres vont ici, d’autres vont là, mais toujours très loin, car un voyage n’est un voyage que lorsque les heures de chemin de fer, additionnées avec les heures de paquebot, donnent un total de dix-huit mois de fatigue (...) A quoi sert donc d’aller si loin ! Or, nous, Pierre Simon Remou et Jacques Dérive, nous avons accompli en quatre jours un voyage que bien peu de Français ont fait, (...) un voyage délicieux à travers le plus adorable pays du monde (...) Nous avons simplement descendu la Seine, la belle et calme rivière, de Paris à Rouen dans un de ces petits bateaux à deux personnes qu’on nomme des Yoles”
Photogramme tiré du film : Bord de Seine, Fernand Bignon, 1936
Mais la navigation fluviale sur des embarcations légères n’est pas sans dangers : le 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo, fille de Victor Hugo et son époux, Charles Vacquerie, se noient dans la Seine à Villequier (Seine-Maritime) à la suite du chavirage de leur canot à voile, insuffisamment lesté pour un coup de vent soudain. De cette peine immense,Victor Hugo écrira le poème « Demain dès l'aube » (“Les Contemplations” 1846).
Grâce à l'évolution de la construction de plaisance qui offre des embarcations accessibles aux classes moyennes, toutes sortes de canots mus à la rame, à la voile ou même à moteur permettent au tourisme fluvial de se développer. Le canoë canadien, facile à utiliser et capable de transporter du matériel de camping, devient le symbole de la démocratisation des loisirs nautiques.
On aménage les berges avec des débarcadères et on publie des guides d’étapes indiquant où on peut goûter les spécialités locales.
Photographie : Portrait de groupe - André Schnellbach
Le ponton installé sur l’île Lacroix en 1908 permet l’accostage de petites embarcations et fait de Rouen une ville étape.
Les témoignages convergent pour décrire un fleuve difficile à naviguer dans les alentours de Rouen. Certains guides invitent les propriétaires de bateau, même avec une embarcation à bas fond, à recourir au service d’un pilote.
En Normandie, la faible inclinaison de la vallée de la Seine a causé la formation de multiples et profonds méandres sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Le guide nautique du bassin de la Seine met en garde contre les dangers que représentent les hauts fonds et le courant de marée qui se fait sentir jusqu’à Caudebec les-Elbeuf, dernière écluse, à 25 km en amont de Rouen.
C’est le mascaret, appelé barre en Normandie, qui correspond à une brusque augmentation du niveau du fleuve provoquée par la vague de la marée montante lors des grandes marées.
Photogramme tiré du film " Aspects du mascaret de la Seine", Robert Dasché, 1947/1965
Ce phénomène atteignait son maximum à Caudebec-en-Caux, à mi-distance environ entre Le Havre et Rouen. On pouvait encore l’observer jusque dans les années 1960 mais il a pratiquement disparu à la suite des aménagements apportés au fleuve (dragage et modification de l'estuaire).
De plus, la circulation commerciale est intense sur cette zone industrielle.
À l’approche de Rouen, les canoéistes peuvent utiliser le bras droit de la Seine de façon à éviter le plus gros du trafic. Le décor est constitué par les falaises et des îles, arborées. Puis, les dix kilomètres suivants traversent les faubourgs industriels de la ville.
L’entrée dans le port de Rouen se fait par le bras droit de la Seine, où sont implantées les installations de l’île Lacroix. Les pontons des Bains Villers et du Touring Club de France permettent aux bateaux d’accoster moyennant une participation financière. Pour les guides touristiques, l’intérêt de la ville réside dans la richesse de son patrimoine historique. Les curiosités sont nombreuses : cathédrale, palais de justice, églises, gros-horloge, vieilles maisons, etc. La ville est bien pourvue en hôtels et est directement reliée à Paris par le chemin de fer.
Le dimanche, les Rouennais eux-mêmes louent des embarcations pour gagner le cadre champêtre de l’île Brouilly ou de l’île aux Cerises à Sotteville-lès-Rouen.
"Déjeuner en famille", Louis Chesneau, vers 1920
On se baigne, on pêche, on flâne…et l’on prend une collation dans les guinguettes de ces paysages bucoliques, à l’écart de la ville et appréciés des citadins depuis le milieu du XIXe siècle.
Photogramme tiré du film "Pêle-mêle" Fernand Bignon, 1938
Les îles, la côte Sainte-Catherine et les collines de Bonsecours constituent une vallée verdoyante en bordure de la ville, mise en valeur par la littérature (Flaubert, Maupassant…), la peinture (Pissarro, Boudin…) et par les photographies.
Ce paysage a également été choisi par les organisateurs de régates qui installent au Cours-la-Reine les tribunes des spectateurs.
Le Cours-la-Reine était une belle avenue bordée d'arbres, très appréciée des promeneurs, longeant la rive gauche du fleuve entre le Pont Corneille et le Pont aux Anglais.
Photographie "Le Cours-la-Reine sous la neige", Louis Chesneau 1910
Mais même à proximité de ces lieux verdoyants, la cohabitation entre la sphère des loisirs et du travail reste une réalité : les péniches sont « amarrées par paquets ». Au milieu du fleuve, les bateaux de commerce et les remorqueurs qui naviguent à bonne vitesse semblent des « monstres », « le port est infernal par le courant et surtout en raison de la navigation intense des péniches, allèges, vedettes, navires, remorqueurs, soulevant un clapotis qui rend intenable les quais », « L'eau et les bords sont couverts de mazout » in Études Normandes, 61e année, n°2, 2012. Sport et territoire en Normandie.
La navigation est encore difficile une dizaine de kilomètres après Rouen. Puis, en descendant l’estuaire de la Seine, le cadre redevient rural. La distance entre les villages s’agrandit et il est de nouveau possible de planter sa tente.
Photogramme tiré du film "Les jours heureux", Robert Prieur, 1950
L’apparition d’une classe moyenne et l’amélioration des conditions de vie des ouvriers (la diminution du temps de travail et la création des congés payés notamment) permettent une première démocratisation du sport dans l’entre-deux-guerres.
L’ouverture de l’autoroute de Normandie en 1946 (la première de France) amorce le retour de parisiens après guerre. Pour le week-end, on peut désormais facilement se rendre sur le littoral normand. Certains plaisanciers construisent leur maison de campagne entre le littoral et la capitale. Le dimanche, ils viennent profiter des plaisirs de la seine.
Dans les années 50, l’apparition de nouveaux matériaux comme le contreplaqué et le polyester permet à un public de plus en plus nombreux d’acquérir des dériveurs faciles à manier. On peut y installer parfois des couchettes ou une petite cuisine. Le fameux “Belouga” apparaît sur la Seine.
Mais tout change à partir de 1960.
Les canots légers sont incapables d’affronter les vagues de remorqueurs et de péniches de plus en plus lourds et importants : ils ne conviennent plus à la descente de la Seine.